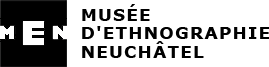La différence - Trois musées, trois regards (03.06.1995 - 07.01.1996) - Revue de presse
C’est une grande leçon qui nous est donnée là et à côté de laquelle il ne faut pas passer. Le terme de leçon est évidemment à prendre dans son sens le plus noble: c’est la méthode d’un itinéraire pour passer des mots aux choses. L’exposition se déroule d’ailleurs sur le mode de l’itinéraire ou, si l’on préfère, de la trajectoire. Complètement habitée par une loi de composition subtile, la juxtaposition des objets, le plus souvent tirés de notre quotidienneté, nous fait découvrir des liaisons, voire des relations profondes, dont nous n’étions pas conscients avant de les avoir vus ainsi assemblés.
Le MEN nous montre qu’il n’y a pas de rupture entre les mots et les choses, quand bien même la substance dont les uns et les autres sont faits est différente. Absence de rupture ne signifie pas superposition, mais correspondance dont l’exploration conduit à repenser le rôle du mythe et de la science, dont les relations sont plus étroites qu’on ne le croit généralement. Les combinaisons qui sont proposées montrent aussi très clairement toute l’épaisseur concrète de l’idéologie dans nos démarches de tous les jours.
La «leçon» est d’autant plus exemplaire qu’elle est double: si elle nous apprend à passer des mots abstraits aux choses concrètes, elle nous montre également comment faire l’inverse. Que peuvent nous révéler des systèmes d’objets et que peuvent-ils nous suggérer ? Si nous passions un peu de temps à chercher à représenter par des combinaisons concrètes d’objets les mots que nous qualifions d’abstraits, peut-être réussirions-nous à mieux comprendre simultanément le monde de la pensée et le monde des choses. S’il est vrai que les réalités mentales sont autre chose que les réalités matérielles, et donc qu’elles sont «différentes», elles n’en demeurent pas moins indissolublement liées dans le processus de la connaissance.
Ce va-et-vient entre les réalités mentales et les réalités matérielles nous fait découvrir quel’abstrait et le concret sont en constante fusion et que vouloir les séparer d’une manière trop radicale conduit à une pensée appauvrie. Faire la différence ne signifie pas séparer,mais réconcilier dans une unité supérieure.
Claude Raffestin, 24 Heures, Lausanne, 22 juin 1995
Les fidèles du musée de Neuchâtel, pour leur part, noteront avec intérêt que son conservateur Jacques Hainard, toujours en effervescence, n’hésite désormais plus à se prendre pour l’Eternel. «J’ai décidé de me mettre dans la peau de Dieu et de porter un regard sur le chaos sociétal actuel en sept jours d’une genèse contemporaine et donc en sept vitrines», assure-t-il, à propos de sa prestation, avec une simplicité de bon aloi. On attend avec impatience la prochaine expo en solo de celui qui avait déjà chaussé l’année précédente les bottines de Karl Marx pour savoir à qui l’homme entend désormais s’identifier pour assumer la suite de son douloureux karma culturel.
«L’art, oui, j’aimerais bien m’attaquer à l’art…» lâche-t-il. Comme Michel-Ange adorait peindre les plafonds, le musée suisse devrait se visiter bientôt le nez en l’air.
Jean-Pierre Tenoux, L’Est républicain, Besançon, 6 septembre 1995
L’exposition se termine (comme souvent) sur une vision apocalyptique qui consacre le triomphe final du virtuel sur le réel. Qu’est devenue «la différence» ?
«Eh bien justement, elle disparaît. Car le virtuel implique fatalement la fin de la différence. C’est l’apothéose de l’indifférence. La dernière exhortation quasi biblique que nous y adressons aux fidèles computérisés, c’est “loguez-vous les uns les autres” ! La dernière station de nos expositions tient toujours un peu de l’ethnologie-fiction: elle est une préfiguration un brin caricaturale de l’évolution de notre société, afin que le visiteur reparte avec ce petit électrochoc en guise de viatique pour nourrir ses réflexions personnelles.
»Nous entrons dans l’ère du “couper-coller”. L’usage généralisé de l’ordinateur est en train d’induire dans nos modes de pensées un type de fonctionnement zappeur et amalgameur qui nous bricole des savoirs en pots-pourris disparates, nous fait parfois aller chercher très loin (sur le grand buffet garni d’Internet) les réponses données par d’autres pour éviter d’avoir à les chercher soi-même, et finira, dans la dissolution générale du sens et la dématérialisation du réel, par nous dissuader tout à fait de réfléchir. C’est le degré ultime de l’indifférence.
Françoise Jaunin (et Jacques Hainard), Voir, Montreux, octobre 1995
Ainsi, la première vitrine est dédiée à l’égalité. En bas, le slogan «tous différents, tous égaux»; en haut, un personnage exprime le déséquilibre croissant de nos sociétés toujours plus sélectives et inégalitaires. Entre ces pôles, des emblèmes (deux statuettes de jumeaux ibdeji dont les scarifications permettent de se reconnaître et d’être reconnus), des caricatures (Tintin dans le pousse-pousse du Lotus bleu, ou comment certains sont plus égaux que d’autres), des stéréotypes (macaronis, rosbifs: la réduction d’autrui à des pratiques alimentaires), des stigmates (une étoile jaune et un J sur un passeport: différencier l’autre sert aussi à l’éliminer).
Encadrant les vitrines et reflétant des étapes du savoir humain, des images de différentes époques se renvoient l’une à l’autre. Un «sauvage» du XVIe siècle, emplumé, tatoué, fait face à un Bochiman des premières années du XXe siècle. Le dessinateur qui a saisi le premier a vu un être, certes bizarre, mais un contemporain avec qui il peut, quand même, communiquer. Trois siècles plus tard, la vision a changé. Darwin est passé par là. L’homme représenté est visiblement au bas de l’échelle de l’évolution. […]
Au-delà de ses qualités, l’exposition «La différence» révèle une ambition commune. La réflexion philosophique de Jacques Hainard, l’empirisme de Michel Côté, la démarche culturelle de Jean Guibal – les trois commissaires – sont les facettes d’un même manifeste: quel est le rôle d’un musée de société ? Pour eux, on ne peut plus se contenter d’y présenter des collections reflétant les us et coutumes de nos arrière-grands-parents ou des ultimes chasseurs-cueilleurs de la planète. La base d’un tel musée, à l’opposé de toute vision statique et accumulative, est l’exposition. Exposer, disent-ils, c’est construire un discours fait d’objets, de textes et d’iconographie qui sont au service d’un propos ou d’une histoire, et non l’inverse. Ces musées doivent être des lieux où l’on vient pour tenter de répondre à des interrogations contemporaines fortes; ils doivent susciter des émotions, des colères, des envies d’en savoir plus.
Emmanuel de Roux, Le Monde, Paris, 6 mars 1996
Par son ouverture internationale et sa manière de confronter les points de vue, ce pari muséographique témoigne de ce que veut être une exposition dans le cadre d’un musée de société: non plus la présentation statique et accumulative de collections, mais la construction d’un discours fait d’objets, textes et images au service d’un propos ou d’une histoire. L’objectif est cette histoire, non l’objet. Les musées de société s’efforcent d’être des lieux où l’on vient tenter de répondre à des interrogations contemporaines fortes.
Jack Ligot, Encyclopædia Universalis (Universalia 1997, Muséologie, pp. 358-359)