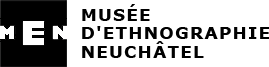10 propositions sur le sens commun
1. D'après Clifford Geertz, le sens commun peut être caractérisé par cinq qualités fondamentales: il est naturel dans la mesure où il prétend aller de soi, couler de source; pratique dans la mesure où il se réfère au bon sens très généralement attribué à la sagesse populaire; mince car il tend à prendre les choses comme elles sont ou paraissent être; non méthodique car il fait intervenir une sagesse du moment proche de l'inconséquence, une sagesse inverse pouvant s'imposer le moment suivant; accessible puisque toute personne saine d'esprit peut saisir et même embrasser ses propositions.
2. On croit qu'on sait penser. On sait parler plus ou moins, communiquer un minimum, mais ce n'est pas parce qu'on a une bouche, des yeux et des oreilles que l'on sait penser. Or tout est fait comme si on savait penser. On dit: «La Russie est ceci», et puis chaque fois que quelqu'un y va: «Ah, non, ce n'est pas du tout comme ça.» Quand on voit ces âneries dans les journaux sur le marché et les lois du marché... Le marché c'est les grandes banques, c'est les banques centrales, et quand on attaque le franc, le Crédit lyonnais fait partie de ceux qui attaquent le franc. Il y a un monsieur, qui a mis son caleçon et sa cravate le matin, qui a femme et enfants, qui décide d'attaquer le franc le matin puis qui rentre à la maison, qui dit: «Oui, j'ai bien travaillé.» Et à sa petite: «Et toi, qu'as-tu fait ?» Ces films-là, on ne les voit jamais. De temps en temps, on voit des personnes à la télévision, mais elle ne fait rien la télévision, elle transmet, c'est ce qu'il y a de plus bête.
3. Une photo sera plus crédible qu'une figure, et une bande-vidéo qu'un bon discours. Des goûts et des couleurs, des méthodes et des idées, chacun son opinion. Mais devant la console de visualisation, on se tait. Visualiser, c'est expliquer. En langue courante, «je vois» a remplacé «je comprends». «C'est tout vu», signifie qu'il n'y a rien à ajouter. Hier: «C'est vrai, je l'ai lu dans le journal.» Aujourd'hui: «J'y ai cru, puisque je l'ai vu à la télé». On n'oppose plus valablement un discours à une image. Une visibilité ne se réfute pas par des arguments. Elle se remplace par une autre. Nous sommes la première civilisation qui peut se croire autorisée par ses appareils à en croire ses yeux. La première à avoir posé un trait d'égalité entre visibilité, réalité et vérité. Toutes les autres, et la nôtre jusqu'à hier, estimaient que l'image empêche de voir. Maintenant elle vaut pour preuve.
4. Le sens commun puise de façon non systématique dans une réserve de prêt-à-penser constituée de proverbes et de maximes, de fables et de paraboles, d'emblèmes et de stéréotypes sociaux, de plaisanteries et de calembours, modes d'expression ancrés dans la langue et la culture qui nous contaminent autant dans notre manière d'agir que de penser. Le sens commun parle donc à travers la langue de façon métaphorique, associant des domaines apparemment disparates. Le langage de tel commentateur sportif fleure bon le champ de bataille, celui de tel politicien s'imprègne de considérations culinaires, celui de tel sociologue du travail présente des senteurs hospitalières, celui de tel médecin évoque l'atelier de réparation automobile, celui de tel doctrinaire évoque les buanderies et les nettoyages de printemps.
5. Alors que le concept de sens commun se réfère à un ensemble d'individus apparemment illimité, les exemples donnés en situation concernent presque toujours un groupe restreint, généralement «les autres» ou «les gens», auquel le locuteur peut avoir ou non l'impression d'appartenir et auquel son interlocuteur peut ou non le rattacher. Il n'y a donc pas un sens commun, mais de multiples sens communs, en relation étroite avec les valeurs et les règles des différents groupes sociaux qui les utilisent comme guides.
6. Les expressions de sens commun reflètent clairement l'intensité de la satisfaction ou de la crise dans laquelle leur énonciateur se trouve plongé. L'absence de problèmes rend ces expressions conciliantes, l'apparition de tensions les radicalise en développant leurs tendances purificatrices. Ainsi, la crise de société que les médias reflètent et ne cessent d'alimenter provoque le retour des valeurs refuges liées à l'ordre, à la propreté, à l'intégrité et à l'efficacité, quand ce n'est pas aux discours fanatiques et aux mouvements de foule susceptibles d'éliminer physiquement quelques boucs émissaires.
7. Ce que nous appelons pensée primitive, prélogique ou sauvage, n'est pas autre chose que la logique pratique, à la fois commode et tournée vers l'action, à laquelle nous avons recours chaque jour, dans nos actes et nos jugements sur les autres ou sur le monde. Lorsque nous classons des hommes politiques ou des peintres, nous n'agissons pas autrement que les primitifs qui, pour mettre de l'ordre dans leur monde, mettent en oeuvre des principes classificatoires dont nous n'avons pas toujours la clé. Dans cette perspective, la science n'est rien de plus qu'un sens commun entraîné et organisé.
8. Comment être au monde sans avoir la tentation de le refaire ? Dans de nombreuses propositions de sens commun, la conjonction «si ...» se présente comme un opérateur de construction, voire de purification du monde. Il s'agit de refaire en mieux ce que nous-mêmes, nos prédécesseurs ou nos contemporains ont partiellement ou totalement raté. Inlassablement, les «si nous avions su» dansent avec les «s'ils étaient ceci ou cela» le tango des temps meilleurs ou la valse des temps jadis.
9. L'opération de purification se manifeste dans d'autres formulations que les énoncés en «si...», la conjonction concernée apparaissant alors de façon implicite. «Y'a qu'à enfermer tous les drogués» signifie que «si on voulait régler définitivement les problèmes posés par les consommateurs de drogues, on les mettrait tous derrière des barreaux». La pensée «y'a qu'à» constitue l'essentiel des conversations de bistrot et s'épanouit dans de nombreux secteurs apparemment plus sérieux, qu'il s'agisse de congrès scientifiques ou de conseils d'administration. La proposition «y'a qu'à recycler» liée aux problèmes d'environnement correspond à «y'a qu'à leur envoyer nos surplus» dans le domaine de l'humanitaire ou à «y'a qu'à déréglementer» lorsqu'il s'agit de relancer l'économie. Par la mise en scène d'une possibilité d'action susceptible de déboucher sur un résultat immédiat, le sens commun propose un remède symbolique à la passivité sociale.
10. Issue des expressions purificatrices, la série des «c'est la faute à...» constitue un réservoir inépuisable de solutions partielles et partiales aux problèmes du moment. Parce qu'en fin de compte, je ne suis pas responsable, tu fais tout ton possible, il justifie sa situation présente, nous sommes laxistes, vous êtes inconséquents et ils nous mènent à la catastrophe. Une telle délégation ou dénégation de responsabilités commence autour du parc à jouets, se prolonge dans les cours de récréation, se systématise dans les premières oppositions organisées à telle ou telle injustice du moment et tend à se figer entre bonne conscience et auto-satisfaction. Elle devient catastrophique quand, en période de crise, elle s'exprime haut et fort à travers des drapeaux et des slogans simplistes.
sources
1. D'après Clifford Geertz. 1986. Savoir local, savoir global: les lieux du savoir. Paris: PUF, pp. 107-116.
2. D'après une interview de Jean-Luc Godard. 1992, le 2 décembre, un mercredi. Encore (16-23 décembre 1992), p. 5.
3. D'après Régis Debray. 1992. Vie et mort de l'image: une histoire du regard en Occident. Paris: Gallimard, pp. 385-386; 391.
4-6, 8-10. D'après Marc-Olivier Gonseth. 1993. L'ordinaire et son ombre. Neuchâtel: Musée d'ethnographie, pp. 32-33; 37; 40; 41-42; 43.
7. D'après Pierre Bourdieu. 1980. Le sens pratique. Paris: Editions de Minuit.